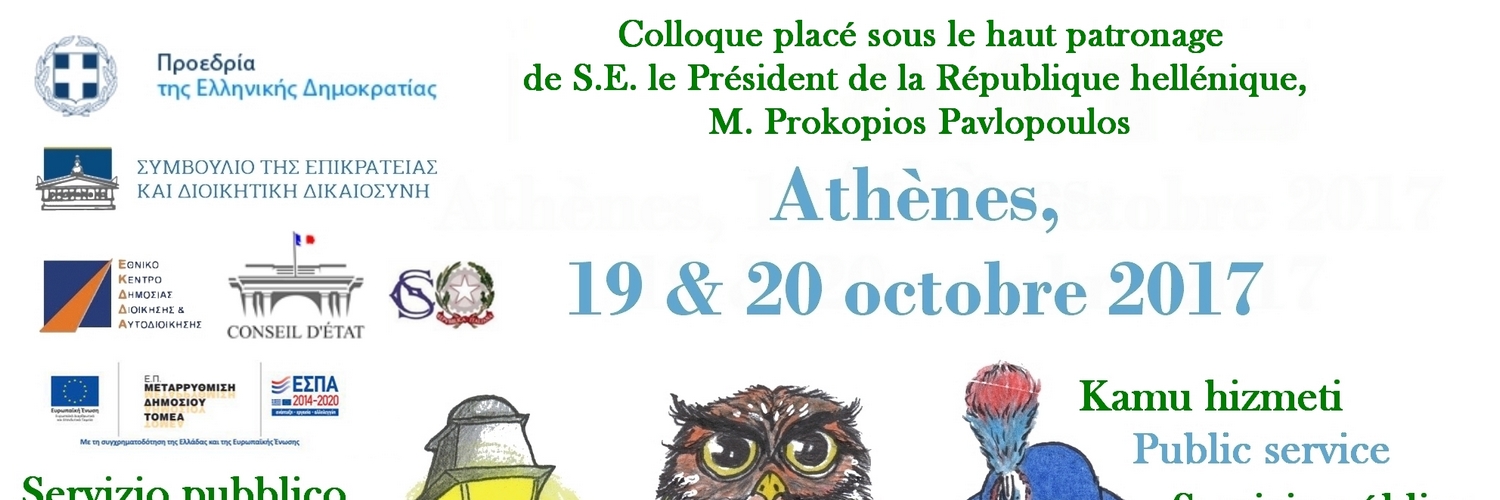Mois : août 2017
Mois : août 2017
Forme constitutionnelle – Egypte
Avec la nouvelle constitution adoptée en 2014, la forme du régime politique égyptien a changé significativement. Malgré que les constitutions de 1971 et de 2014 aient promus, toutes les deux, un régime mixte entre le régime parlementaire et présidentiel, il existe entre les deux d’importantes différences. Si la Constitution de 1971 est une constitution de
DetailsEléments de l’histoire constitutionnelle égyptienne
L’évolution constitutionnelle de l’Egypte traduit l’évolution d’un pays qui, après une longue occupation ottomane, a retrouvé sa place dans le concert des nations au XIXe siècle. Une Constitution ne fait que poser un cadre juridique, sans conditionner nécessairement la pratique ultérieure du régime. La simple connaissance théorique de la règle de droit ne permet pas,
DetailsSecond Colloque international du LM-DP : Athènes 19-20 oct. 2017
Le 2e grand colloque international du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public a eu lieu à Athènes les 19-20 octobre 2017. Son programme est toujours disponible ci-dessous. L’allocution de clôture du pr. Antoine Messarra qui en a fait la synthèse se trouve en ligne LA et vous pouvez également lire l’allocution du président Stirn ICI. Vous
DetailsLes intervenants [colloque international du LM-DP]
Vous trouverez ci-dessous la liste des 53 personnalités participant au second colloque international du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public. En cliquant sur chaque patronyme, vous aurez accès au CV (généralement en langue française) de nos contributrices et de nos contributeurs. Cette liste est dressée par ordre de prise de parole au colloque en fonction du
Details